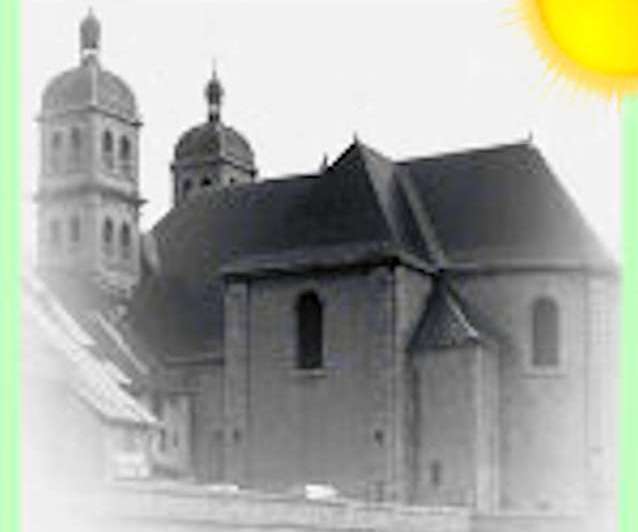Calendrier des Rencontres
Maison Paroissiale – 17 rue Alphand, Briançon
14 h – 16h
Jeudi 26 septembre 2024
Jeudi 17 octobre 2024
Jeudi 14 novembre 2024
Jeudi 12 décembre 2024
Jeudi 16 janvier 2025
Jeudi 6 février 2025
Jeudi 13 mars 2025
Jeudi 24 avril 2025
Jeudi 15 mai 2025
Jeudi 12 juin 2025
***********
__________________________________
Ce groupe s’est constitué à l’initiative du Père Bertrand Gournay, il y a déjà de longues années… Lorsqu’il est parti à Tamanrasset, nous avons continué à lire la Bible, en lien avec le Père Bertrand avec qui nous correspondons régulièrement.